Culture de masse
La culture de masse fait typiquement référence à la culture qui émerge des processus de production centralisés des médias de masse. Il convient toutefois de noter que le statut de ce terme fait l’objet de contestations permanentes – comme dans l’identification par Swingewood (1977) de ce terme comme un mythe. Lorsqu’il est lié à la notion de société de masse, il devient alors une variante spécifique d’un thème plus général, à savoir la relation entre les significations sociales et l’allocation des chances de vie et des ressources sociales. Considérée comme un dépôt de signification sociale, la culture de masse fait partie d’un groupe de termes qui comprend également la haute culture (ou culture d’élite), la culture d’avant-garde, la culture populaire et (ultérieurement) la culture postmoderne. L’interprétation et les limites de chacune de ces catégories font régulièrement l’objet de débats et de différends. Cela devient particulièrement évident dans les tentatives de définition ostensive (c’est-à-dire la citation d’exemples de chaque terme et le raisonnement employé pour justifier leur attribution à la catégorie en question). Combinés, ces concepts constituent un système de différences, de sorte qu’un changement de sens de l’un quelconque de ses termes est explicable à travers et par la relation changeante qu’il entretient avec les autres. Ces mêmes termes fonctionnent fréquemment comme des catégories évaluatives qui – tacitement ou explicitement – incorporent des jugements sur la qualité de ce qu’ils affectent de décrire.
Dans son introduction à Mass Culture Revisited de Rosenberg et White (1971), Paul Lazarsfeld a suggéré qu’aux États-Unis, la controverse et le débat concernant la culture de masse avaient le plus clairement fleuri entre 1935 et 1955. C’est à cette époque que la reconnaissance des médias de masse comme une force culturelle importante dans les sociétés démocratiques a coïncidé avec le développement de formes totalitaires de contrôle, associées aux régimes et aux politiques médiatiques d’Hitler et de Staline. Les affinités perçues entre ces évolutions ont suscité des préoccupations quant à la meilleure façon de défendre les institutions de la société civile, la culture en général et la haute culture en particulier contre les menaces auxquelles elles étaient confrontées. Ces préoccupations ont contribué à façonner la structure du débat sur la culture de masse à cette époque. Il est certain que ce qui était évident parmi les commentateurs sociaux et les critiques culturels américains, c’était une antipathie généralisée envers la culture de masse qui dépassait les différences entre les penseurs conservateurs et critiques. Même parmi les défenseurs de la culture de masse, le ton justificatif était caractéristiquement défensif et apologétique (Jacobs 1964).
Pour beaucoup de critiques, une stratégie typique était de définir négativement la culture de masse comme »l’autre » de la haute culture (Huyssen 1986). Cette convergence dans la définition et la compréhension de la culture de masse comme étant tout ce que la haute culture n’est pas, s’est produite dans des circonstances où la conception de la haute culture qui était valorisée pouvait être soit (1) généralement conservatrice et traditionnelle, soit (2) spécifiquement moderniste et avant-gardiste. Pour certains conservateurs, dans un courant de pensée influencé par Ortega Y Gasset et T. S. Eliot, cette conception a pris la forme d’une nostalgie non dissimulée d’un passé plus aristocratique et prétendument plus ordonné. Ils avaient donc tendance à considérer que la menace posée par la culture de masse était générée par « le bas » (par « les masses » et leurs goûts). Pour les théoriciens critiques tels que Theodor Adorno, la culture de masse servait des intérêts qui venaient d’en haut (les propriétaires du capital) et était une expression de l’expansion exploitante des modes de rationalité qui avaient été jusqu’alors associés à l’organisation industrielle. Selon ce groupe critique, les attributs d’une haute culture moderniste sont qu’elle est – ou plutôt aspire à être – autonome, expérimentale, contradictoire, hautement réflexive par rapport aux médias par lesquels elle est produite, et le produit du génie individuel. La perspective correspondante sur la culture de masse est qu’elle est complètement marchandisée, qu’elle utilise des codes esthétiques conventionnels et formels, qu’elle est culturellement et idéologiquement conformiste, et qu’elle est produite collectivement mais contrôlée centralement en accord avec les impératifs économiques, les routines organisationnelles et les exigences technologiques de ses médias de transmission. L’émergence d’une telle culture de masse – une culture qui est par la force des choses faite pour la population plutôt que faite par elle – sert à la fois à fermer la résistance associée à la culture populaire et à l’art folklorique et le sérieux de l’objectif avec lequel la haute culture est identifiée.
Le débat autour de cette opposition entre la culture du haut modernisme et la culture de masse a été, pour la plupart, porté par les chercheurs en sciences humaines. Ce qui s’est avéré être un point de contact avec les spécialistes des sciences sociales, c’est la préoccupation connexe de ces derniers quant à savoir si le développement de la modernité (comprise comme un processus social) était associé à l’émergence de la société de masse. Dans la mesure où la notion d’une telle société est fondée sur le contraste entre le petit nombre (organisé) et le grand nombre (désorganisé), Giner (1976) suggère que sa longue préhistoire dans la pensée sociale et politique remonte à la Grèce classique. De la même manière, Theodor Adorno avait vu les fondements de la culture de masse comme remontant aussi loin que le récit d’Homère, dans L’Odyssée, de la rencontre d’Ulysse avec les sirènes et de l’attrait séduisant, mais profondément insidieux, de ces dernières.
Une théorie spécifiquement sociologique de la société de masse, cependant, avec ses antécédents dans les écrits d’Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill et Karl Mannheim, est tout à fait plus récente. Formulée par des auteurs tels que William Kornhauser et Arnold Rose, cette théorie s’est attachée à mettre en lumière certaines tendances sociales plutôt qu’à offrir une conception totalisante de la société moderne. La théorie avance néanmoins un ensemble d’affirmations sur les conséquences sociales de la modernité, affirmations qui sont typiquement transmises par le biais d’un contraste stylisé avec les caractéristiques prétendument ordonnées de la société « traditionnelle » ou, moins fréquemment, avec les formes de solidarité, de collectivité et de luttes organisées qui illustrent la société « de classe ». En bref, les relations sociales sont interprétées comme ayant été transformées par la croissance et le déplacement vers les villes, par le développement des moyens et de la vitesse de transport, la mécanisation des processus de production, l’expansion de la démocratie, la montée des formes bureaucratiques d’organisation et l’émergence des médias de masse. On prétend que ces changements ont pour conséquence un affaiblissement des liens primordiaux d’appartenance à un groupe primaire, de parenté, de communauté et de localité. En l’absence d’associations secondaires efficaces qui pourraient servir d’agences de pluralisme et de tampons entre les citoyens et le pouvoir centralisé, ce qui émerge, ce sont des individus peu sûrs et atomisés. Ils sont considérés comme constituant, selon une image influente de l’époque, ce que David Reisman et ses associés ont appelé « la foule solitaire ». La conduite »orientée vers l’autre » de ces individus n’est ni sanctifiée par la tradition ni le produit d’une conviction intérieure, mais elle est plutôt façonnée par les médias de masse et la mode sociale contemporaine.
Dans la version de la thèse de C. Wright Mills (1956), le contraste pertinent (et centré sur les médias) n’était pas tant entre le passé et le pré sent, qu’entre une possibilité imaginée et une tendance sociale en accélération. La différence la plus significative se situe entre les caractéristiques d’une » masse » et celles d’un » public « , ces deux termes (de type idéal) se distinguant l’un de l’autre par leurs modes de communication dominants. Un » public » est conforme aux normes de la théorie démocratique classique, dans la mesure où (1) il y a pratiquement autant de personnes qui expriment des opinions que de personnes qui les reçoivent ; (2) les communications publiques sont organisées de telle sorte qu’il est possible de répondre rapidement et efficacement à toute opinion exprimée ; (3) l’opinion ainsi formée trouve un débouché pour une action efficace ; et (4) les institutions autoritaires ne pénètrent pas le public, qui est donc plus ou moins autonome. Dans une »masse », (1) beaucoup moins de personnes expriment des opinions qu’elles n’en reçoivent ; (2) les communications sont tellement organisées qu’il est difficile de répondre rapidement ou efficacement ; (3) les autorités organisent et contrôlent les canaux par lesquels l’opinion peut se traduire en action ; et (4) la masse n’a aucune autonomie par rapport aux institutions.
Comme ces images l’impliquent, et comme Stuart Hall devait le suggérer par la suite, ce qui se cachait derrière le débat sur la culture de masse était le sujet (pas si) caché des »masses ». Pourtant, il s’agissait d’une catégorie sociale dont Raymond Williams avait exprimé des doutes sur l’existence même, notant avec ironie qu’elle semblait invariablement constituée de personnes autres que nous. Ce scepticisme était partagé par Daniel Bell (1962), un penseur par ailleurs très différent de Williams. En critiquant la notion de l’Amérique comme une société de masse, il a indiqué les significations et associations souvent contradictoires qui s’étaient rassemblées autour du mot « masse ». Il pouvait signifier un public hétérogène et indifférencié, ou le jugement des incompétents, ou la société mécanisée, ou la société bureaucratisée, ou la foule, ou toute combinaison de ces éléments. On demandait simplement au terme de faire beaucoup trop de travail explicatif.
De plus, au cours des années 1960, un tel évidement de la base formelle et cognitive du concept de culture de masse a été de plus en plus complété par des défis empiriques beaucoup plus directs. L’émergence d’une contre-culture basée sur la jeunesse, le mouvement des droits civiques, l’opposition à la guerre du Vietnam, l’émergence du féminisme de la deuxième vague, ainsi que les contradictions et les ambiguïtés du rôle des médias, qui ont à la fois documenté et contribué à ces développements, ont tous contribué à remettre en question la thèse de la société de masse. En outre, le contrôle de l’industrie de la musique populaire par une poignée de grandes entreprises (Peterson & Berger 1975) et de la production cinématographique par les grands studios a fait l’objet de sérieuses contestations de la part de producteurs culturels indépendants ayant leurs propres priorités (Biskind 1998). Le résultat (pendant une décennie au moins, jusqu’à la réaffirmation éventuelle du contrôle des entreprises) a été une culture médiatique beaucoup plus diversifiée. Et dans ce qui était peut-être explicable comme une partie de réaction, une partie de provocation vis-à-vis d’une orthodoxie antérieure, on a également vu apparaître des cas de soutien universitaire de style populiste à la notion même de culture de masse – comme, par exemple, dans le Journal of Popular Culture. Si cette dernière tendance a parfois fait preuve d’un enthousiasme irréfléchi pour l’éphémère et d’une négligence à l’égard de l’analyse institutionnelle, elle a néanmoins présagé la reconnaissance plus générale de la diversité de la culture de masse qui s’est manifestée au cours des années 1970 (p. ex., Gans 1974).
Durant les années 1980, l’accent mis sur la réception culturelle des formes culturelles populaires a attiré des travaux empiriques novateurs (Radway 1984 ; Morley 1986) à un moment où la notion de postmoderne faisait l’objet d’une attention critique soutenue. Le postmodernisme n’a rien de l’antagonisme du haut modernisme envers la culture de masse. Au contraire, à mesure que les preuves de l’effacement des frontières culturelles se multipliaient, les praticiens de l’isme postmoderne se sont interrogés sur les fondements mêmes de ces contrastes entre » haute » et » masse » et sur les distinctions hiérarchiques qui les soutenaient (Huyssen 1986) ou ont procédé (de manière plutôt factuelle) à leur ignorance. Par exemple, le travail sur les feuilletons télévisés a subverti la convention du dédain critique pour ces textes en dirigeant l’attention vers des complexités structurelles telles que les intrigues multiples, l’absence de clôture narrative, la problématisation des frontières textuelles et l’engagement du genre avec les circonstances culturelles de ses audiences (Geraghty 1991).
Dans ses formes »classiques », la thèse de la culture de masse/société de masse a donc perdu beaucoup de son pouvoir de persuasion. Des permutations contemporaines de ses affirmations sont néanmoins perceptibles, par exemple, dans les écrits post-marxistes de Guy Debord et Jean Baudrillard, et dans l’affirmation du critique conservateur érudit George Steiner selon laquelle il est fallacieux de soutenir qu’il est possible d’avoir à la fois la qualité culturelle et la démocratie. Steiner insiste sur la nécessité du choix. Ce sont toutefois les raffinements apportés au concept étroitement lié d' »industrie culturelle » qui pourraient s’avérer être l’héritage le plus durable et le plus prometteur de cette thèse (Hesmondhalgh 2002). L’industrie culturelle avait été identifiée par Adorno et son collègue Max Horkheimer comme un terme plus acceptable que celui de » culture de masse « , à la fois parce qu’il mettait en avant le processus de marchandisation et parce qu’il identifiait le lieu de détermination comme étant le pouvoir des entreprises plutôt que la population dans son ensemble. Tel qu’il était conçu à l’origine, il présentait une conception trop sombre et trop totalisante du contrôle culturel. L’accent mis sur la polysémie des textes médiatiques ou sur l’ingéniosité des publics médiatiques a apporté un important correctif méthodologique. Mais ces approches pouvaient aussi être surjouées, et la mondialisation de la production médiatique ainsi qu’une résurgence de l’analyse institutionnelle et de l’économie politique parmi les spécialistes des médias au cours de la dernière décennie ont ravivé l’intérêt pour le concept d’industrie culturelle.
- Bell, D. (1962) America as a Mass Society : A Critique. In : La fin de l’idéologie. Free Press, New York, pp. 21-38.
- Biskind, P. (1998) Easy Riders ; Raging Bulls. Simon & Schuster, New York.
- Gans, H. (1974) Popular Culture and High Culture. Basic Books, New York.
- Geraghty, C. (1991) Women and Soap Opera. Polity Press, Cambridge.
- Giner, S. (1976) Mass Society. Martin Robertson, Londres.
- Hesmondhalgh, D. (2002) The Cultural Industries. Sage, Londres.
- Huyssen, A. (1986) After the Great Divide. Macmillan, Londres.
- Jacobs, N. (Ed.) (1964) Culture for the Millions ? Beacon Press, Boston.
- Morley, D.(1986) La télévision familiale. Comedia, Londres.
- Peterson, R. & Berger, D. G. (1975) Cycles in Symbol Production : Le cas de la musique populaire. American Sociological Review 40(2) : 158-73.
- Radway, J. (1984) Reading the Romance. University of North Carolina Press, Chapel Hill.
- Rosenberg, B. & White, D. M. (Eds.) (1971) Mass Culture Revisited. Van Nostrand, New York.
- Swingewood, A (1977) The Myth of Mass Culture. Macmillan, Londres.
- Wright Mills, C. (1956) The Power Elite. Oxford University Press, New York.
Retour en haut
Retour à la sociologie de la culture.
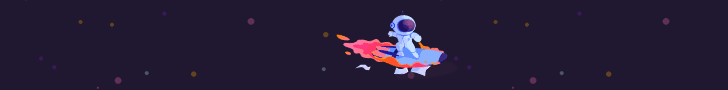
.




