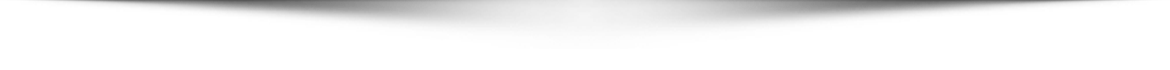Accords d’Helsinki
BIBLIOGRAPHIE
Les accords d’Helsinki (ou, selon leur appellation officielle, l’acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe) ont été signés le 1er août 1975. Les accords d’Helsinki sont l’aboutissement d’un processus qui trouve son origine dans les années 1950, lorsque l’Union soviétique de l’époque a lancé une campagne en faveur de la création d’une conférence européenne sur la sécurité régionale. En mai 1969, le gouvernement finlandais a proposé Helsinki comme lieu de réunion de cette conférence. En novembre 1972, les représentants de trente-trois États européens ainsi que les États-Unis et le Canada ont entamé des discussions sur la mise en place du cadre d’une telle conférence paneuropéenne sur la sécurité. Le 1er août 1975, les dirigeants de ces trente-cinq États ont signé l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.
L’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe est un accord politiquement contraignant qui contient quatre sections ou « corbeilles », comme on les appelle communément. La première corbeille comprend une déclaration de principes guidant les relations entre les États participants à l’accord. Ces principes comprennent le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La deuxième section porte sur la coopération économique, scientifique et environnementale. Le troisième panier traite de questions telles que la libre circulation des personnes et la liberté d’information. Ensemble, le troisième panier et le principe 7 du premier panier constituent la « dimension humaine » des accords d’Helsinki. Le quatrième panier concerne le processus de suivi après la conférence. Les principales tâches de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) étaient la prévention des conflits, l’alerte précoce et la réhabilitation post-conflit.
Après la Conférence d’Helsinki, une série de conférences de suivi ont eu lieu à Belgrade (1977-1978), Madrid (1980-1983), Vienne (1986-1989) et Helsinki (1992). Ces conférences ont conduit à de nombreuses modifications de la nature et de la portée de la CSCE. La CSCE, telle qu’elle était connue dans sa phase d’ouverture de 1975 à 1994, n’était pas une institution internationale formelle. Son absence de structures formelles s’est avérée être un avantage pendant la période de la guerre froide, dans son rôle principal d’intermédiaire entre l’Ouest et le bloc de l’Est. Grâce à sa composition diplomatique fluide, elle a tenté, dans la période précédant l’éclatement de l’Union soviétique, de prévenir les conflits entre les puissances du bloc occidental et du bloc oriental et a essayé de s’engager dans la réduction du fossé politique entre les deux blocs. Dans la période qui a suivi l’Acte final de 1975, de nombreuses ONG de défense des droits de l’homme basées à Helsinki ont été créées dans le bloc soviétique. Bien que persécutés dans leur pays d’origine, ces groupes ont contribué à mettre en lumière les violations des droits de l’homme dans le bloc de l’Est. L’éclatement de l’Union soviétique et la guerre en ex-Yougoslavie ont obligé la CSCE à repenser son rôle dans le nouvel ordre mondial. La réaction de la CSCE à l’évolution de la situation mondiale a finalement conduit à sa transformation de processus diplomatique en une organisation internationale formalisée.
En 1989, le document de conclusion de la réunion de suivi de Vienne de la CSCE a ajouté une dimension supplémentaire à la protection des droits de l’homme sous la forme d’un processus de surveillance en quatre étapes. Ce processus, connu de manière informelle sous le nom de « mécanisme de la dimension humaine », a examiné des questions en rapport avec la dimension humaine des accords d’Helsinki. Au cours de la première étape de ce processus de suivi, des informations seraient échangées par les voies diplomatiques. La deuxième étape impliquerait l’organisation de réunions bilatérales avec d’autres États participants et exigerait d’eux qu’ils échangent des questions relatives à des problèmes particuliers de droits de l’homme. Au cours de la troisième étape, tout État serait en mesure de porter des cas pertinents à l’attention des autres États participants. Dans la dernière étape, les États participants pourraient aborder les questions pertinentes lors de la conférence sur la dimension humaine de la CSCE ainsi que lors des réunions de suivi de la CSCE. Ce mécanisme a été utilisé soixante-dix fois en 1989 pendant les événements qui ont conduit à l’éclatement de l’Union soviétique.
En 1990, le document final de la réunion de Copenhague sur la dimension humaine de la CSCE a apporté de nouveaux changements au fonctionnement de la CSCE dans l’ère de l’après-guerre froide. Dans le document de Copenhague, les Etats participants ont exprimé leur conviction qu’en établissant un nouvel ordre démocratique en Europe de l’Est, il fallait tenir pleinement compte des valeurs de la démocratie pluraliste, de l’Etat de droit et des droits de l’homme. Il est important de noter que les États participants violeraient leurs engagements envers la CSCE s’ils mettaient en place un système politique non démocratique. Le document de Copenhague mettait particulièrement l’accent sur les droits linguistiques, culturels et religieux, notant que les questions relatives aux minorités nationales ne pouvaient être résolues que dans un cadre politique démocratique fondé sur l’État de droit et avec un système judiciaire indépendant. Le document contenait également des recommandations visant à améliorer la mise en œuvre des engagements énoncés dans la dimension humaine des accords d’Helsinki. Celles-ci comprenaient une recommandation visant à déployer des experts indépendants pour examiner les situations de conflit potentiel sur le terrain.
Le 21 novembre 1990, les chefs d’État et de gouvernement des États participants de la CSCE ont signé la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Cette charte convenait que les États coopéreraient et se soutiendraient mutuellement dans le but de rendre « irréversibles » les acquis démocratiques de l’ancien bloc soviétique. » La charte a apporté des changements institutionnels et structurels à la CSCE et a conduit finalement à la création de nouvelles structures et de nouveaux postes au sein de l’organisation, à savoir le secrétaire général, le haut commissaire pour les minorités nationales, une assemblée parlementaire, un conseil ministériel (composé des ministres des affaires étrangères des États participants), le conseil permanent, le président en exercice (il s’agit d’une fonction tournante occupée à tour de rôle par le ministre des affaires étrangères de chaque État participant) et l’initiation de réunions régulières au sommet des chefs d’État ou de gouvernement des États participants.
Lors de la réunion de Moscou de la dimension humaine de la CSCE, le 3 octobre 1991, le mécanisme de surveillance (« mécanisme de la dimension humaine ») établi dans le document de conclusion de la conférence de suivi de Vienne de 1989 a été modifié pour créer un mécanisme en cinq étapes pour l’envoi de rapporteurs chargés d’enquêter sur les violations des droits de l’homme dans les États participants. Le « mécanisme de Moscou » permettait à un groupe d’États participants d’envoyer une mission dans un autre État participant même si ce dernier ne l’acceptait pas. Ce principe est connu sous le nom de « consensus moins la partie en question » ou « consenus moins un ». Les rapporteurs envoyés dans de telles missions sont habilités à faciliter la résolution d’un problème particulier lié à la dimension humaine de la CSCE. Le principe du « consensus moins un » a été formellement adopté dans le Document de Prague sur le développement futur des institutions et structures de la CSCE, produit lors de la deuxième réunion du Conseil des ministres de la CSCE en janvier 1992. Ce document permettait au Conseil des ministres d’adopter des sanctions formelles à l’encontre des États participants jugés en infraction avec leurs engagements en matière de droits de l’homme. Cette procédure d’enquête a été utilisée, par exemple, dans le cadre de l’enquête sur les attaques contre des civils non armés en Bosnie et en Croatie. A la suite de ces interventions, la CSCE a décidé de modifier le mécanisme de Moscou, pratiquement lourd, en faveur de la mise en place de missions ad hoc qui devaient être appelées « missions de longue durée ».
La quatrième réunion de suivi de la CSCE s’est tenue à Helsinki en 1992 (connue sous le nom de Helsinki II). La question du rôle de la CSCE dans l’Europe post-communiste figurait en bonne place à l’ordre du jour. Le document de conclusion de la conférence d’Helsinki II a noté les dangers posés par le nationalisme agressif, la xénophobie, les conflits ethniques et les violations des droits de l’homme dans les nouveaux États post-soviétiques et a mis en place un certain nombre de mécanismes de prévention des conflits. Le plus important d’entre eux a été la création officielle du poste de Haut Commissaire pour les minorités nationales. Ce poste a été créé dans le but de faire pression sur les États pour qu’ils améliorent leur bilan en matière de droits individuels et collectifs. Le Haut Commissaire pour les minorités nationales agit en tant que médiateur dans les différends entre groupes de minorités nationales qui ont le potentiel de se transformer en conflits dans la zone couverte par la CSCE. Helsinki II a représenté une évolution majeure dans l’histoire de la CSCE. Celle-ci est passée du statut de processus diplomatique à celui d’organisation internationale formelle. En 1995, la CSCE a été officiellement rebaptisée Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Elle est aujourd’hui la plus grande organisation régionale de sécurité au monde, comptant cinquante-cinq États parmi ses membres.
Voir aussiBosnie-Herzégovine ; Croatie ; Union soviétique.
BIBLIOGRAPHIE
Bloed, Arie, ed. D’Helsinki à Vienne : documents de base du processus d’Helsinki. Dordrecht, Pays-Bas, et Boston, 1990.
–. Les défis du changement : Le sommet d’Helsinki de la CSCE et ses suites. Dordrecht, Pays-Bas, et Boston, 1994.
Bloed, Arie, et Pieter Van Dijk, eds. Essais sur les droits de l’homme dans le processus d’Helsinki. Dordrecht, Pays-Bas, et Boston, 1985.
Heraclides, Alexis. Helsinki II et ses suites : La transformation de la CSCE en une organisation internationale. New York, 1993.
–. S ecurity and Cooperation in Europe : La dimension humaine, 1972-1992. Londres et Portland, Ore, 1993.
Kovacs, Laszlo. « L’OSCE : Present and Future Challenges ». Helsinki Monitor 6, no. 3 (1995) : 7-10.
Maresca, John M. To Helsinki : La conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, 1973-1975. Durham, N.C., 1985.
Russell, Harold S. « The Helsinki Declaration : Brobdingnag ou Lilliput ? » American Journal of International Law 70, no 2 (1976) : 242-272.
Thomas, Daniel C. The Helsinki Effect : International Norms, Human Rights, and the Demise of Communism. Princeton, N.J., 2001.
Patrick Hanafin
.